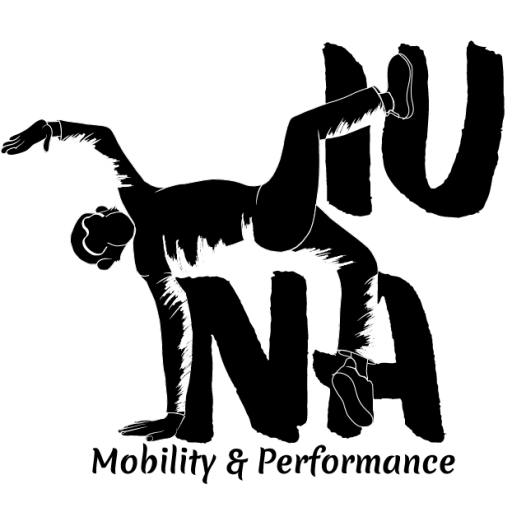Dans cet article, nous allons voir les mécanismes de la contraction musculaire des muscles striés squelettiques 1. C’est une partie très théorique et abstraite mais elle est nécessaire et permettra entre autres de comprendre les différents types de contractions, le rôle de certaines protéines ainsi que d’autres nutriments. Investir du temps pour comprendre le micro est parfois nécessaire pour mieux appréhender le macro.
Cette approche est basée sur le modèle de Huxley de 1972. Ici, nous ne parlerons que des phénomènes qui se passent au niveau des muscles, l’aspect neuro, expliquant comment le cerveau ordonne au muscle de se contracter, sera traité dans un prochain article. Dans cette optique nous n’aborderons pas non plus la production d’ATP. La contraction musculaire est complexe et tout expliquer dans un seul article serait trop long.
La structure du muscle strié squelettique
Un peu de vocabulaire
Dans sa conception la plus simple, un muscle est constitué d’une multitude de fibres musculaires, qui peuvent être vues comme des “mini muscles”. La fibre musculaire est elle-même constituée de sous-ensembles appelés myofibrilles. Le liquide entourant les myofibrilles est appelé le sarcoplasme. Le sarcoplasme joue un rôle essentiel dans la production d’énergie car il contient l’ATP, les phosphagènes et des mitochondries.
Un niveau de détail plus bas, chaque myofibrille est entourée d’un réticulum 2 sarcoplasmique essentiel dans la libération du calcium- qui permet la contraction musculaire – comme nous le verrons plus loin.
Chaque myofibrille est composée de sous-unités appelées sarcomères – c’est l’unité contractile de base, celle qui contient les protéines contractiles 3.
A leurs tours, les sarcomères sont constitués de deux bandes :
-
Des bandes sombres, les bandes A (Anisotropes)
-
Des bandes claires, les bandes I (Isotropes)
-
Au centre des bandes A, une bande plus claire, la bande H
-
La bande H est interrompue par une ligne sombre, la ligne M
-
Chaque bande I est découpée en 2 parts égales, par une bande sombre la ligne Z qui délimite deux sarcomères.
Quelques notions supplémentaires :
Maintenant que nous avons compris la structure des muscles, nous pouvons nous intéresser à la contraction musculaire à proprement parlé. Mais avant cela il nous reste à définir les 2 protéines majeures dans la contraction: l’actine et la myosine mais également la tropomyosine et la troponine.
Chaque myofibrille est constituée de différents filaments, certains épais et d’autres fins qui ensemble constituent le sarcomère (l’unité contractile).
Les filaments épais – Myosines et protéines associés.
La tête de la myosine contient 2 sites, le premier correspond au site de liaison de l’ATP et le 2eme s’associe à l’actine et permet le raccourcissement du sarcomère.

Source: https://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/2c1a.html
Les filaments fins – Actine, tropomyosine, troponine
Les bases moléculaires de la contraction musculaire
Afin de ne pas nous perdre, dans cet article nous ne décrirons pas la transmission de l’influx nerveux. Ceux-ci sont complexes et font intervenir d’autres notions. Cependant nous pouvons retenir la chose suivante: la transmission de l’influx nerveux permet une libération du calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique. C’est cette libération de calcium qui va permettre la contraction musculaire.
Le cycle Actine-Myosine-ATP

Source: https://www.nagwa.com/fr/explainers/676192534258/
La base de la contraction musculaire repose sur les interactions entre les molécules d’actine, de myosine en présence d’ATP. Il s’agit donc de transformer des molécules chimiques et énergie mécanique. La contraction peut être vue de manière schématique comme le glissement de la tête de la myosine sur l’actine en un cycle de 4 étapes.
-
Etape 1 – Le repos: Au repos, l’ATP est fixe sur la tête S1 de la myosine
-
Etape 2 – La libération du Calcium: Lorsque le calcium est libéré dans les myofibrilles, il se fixe sur la troponine ce qui induit un changement spatiale de la troponine qui libère le site de liaison actine myosine
-
Etape 3 – Hydrolyse de l’ATP: La libération du Ca provoque la stimulation de l’ATPases 4 qui à son tour provoque l’hydrolyse de l’ATP en ADP + Pi 5
-
Etape 4 – Pivotement de la myosine: L’énergie générée provoque alors le pivotement de la tête S1 tirant l’actine vers le centre du sarcomère et provocant le raccourcissement de ce dernier
Il faut à présent répéter le cycle et pour cela une nouvelle molécule d’ATP devra être formée et hydrolysée. Nous verrons dans le prochain article comment cela fonctionne.
Conclusion
Nous avons passé en revue le modèle le plus populaire de la contraction musculaire, le modèle de Huxley. Cependant, il nous reste beaucoup de points à investiguer, comment l’influx nerveux parvient-il au muscle? Comme l’ATP est-il produit? Est-ce que toutes les fibres musculaires sont équivalentes? etc.. Tout ceci sera expliqué dans les prochains articles.
Aussi, ce modèle, bien qu’il permette d’expliquer énormément de choses est assez vieux et ne prend pas en compte les dernières avancées en matière de physiologie. Par exemple, ce modèle ne permet pas d’expliquer l’expansion radiale du muscle, c’est-à-dire que lors de la contraction musculaire, le muscle se raccourcit mais il s’épaissit en même temps, c’est donc une mouvement en 3 dimensions et non pas en 2 dimensions comme prévu dans le modèle.
Pour ne rien rater des prochains articles, n’oublie pas de t’abonner à la newsletter pour les recevoir directement dans ta boite mail. Comme toujours, n’hésite pas non plus à me dire en commentaires ce que tu as pensé de l’article.
Sources:
1 Les différents types de muscles sont: les muscles lisses (ex: les muscles aidant à la digestion) – contractions involontaires; les muscles striés cardiaques – contractions involontaires; et les muscles striés squelettiques – contractions volontaires.
2 Réticulum: réseau
3 Les protéines contractiles sont des protéines dont la déformation spatiale est responsable d’un mouvement de la cellule.
4 Enzymes (molécules qui accélèrent une réaction chimique) qui permettent l’hydrolyse de l’ATP
5 Phosphagènes